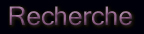Et le génie naquit de la folie…
La douleur avait pris naissance quelque part à la base de son dos. Une douleur sourde qui visiblement avait bien l’intention de l’envahir, jusqu’à la dernière cellule de son être. Mais qu’importe, elle savait qu’elle avait un refuge où même la souffrance physique ne pouvait l’atteindre. Elle y couru aussi vite que son esprit le lui permettait, franchissant sans grande difficulté les méandres de son système neuronal. Cela faisait bien longtemps qu’elle se jouait de ses barrières, de ces sécurités qu’un esprit sain organise et structure dans un corps sain. Mais voilà, «Mens sana in corpore sano » ne pouvait guère s’appliquer à Diana.
A tous, elle donnait l’illusion d’une certaine stabilité d’esprit, à tous mais surtout à elle-même. Maintenant encore, vingt-deux ans après les faits, lorsqu’elle le devine dans le reflet de la fenêtre du centre, qu’elle le sait juste derrière elle, tellement proche et totalement inaccessible, elle se demande quelle folie a touché ces hommes qui ne savent pas lire en elle la vérité. A moins qu’ils en aient peur, tout simplement. C’est ainsi depuis qu’il l’a placée ici, il y a quatre ans. Il vient, la chemise débraillée et la sacoche jetée sur la hanche. Pendant des heures il la caresse d’un regard lointain, puis repart, sans lui parler, sans l’embrasser, comme un voleur, comme il est né ! Toujours ce même rituel, ce va-et-vient, comme des contractions…
Lorsque les symptômes étaient devenus trop flagrants, elle les avait niés farouchement, avec une vigueur accompagnant crescendo la souffrance. Son mari n’avait rien vu, rien deviné. Encore aurait-il fallu qu’il se donne la peine de la regarder autrement, comme une femme ou une amante, et non comme un objet intellectuel que l’on expose. Il était fier de sa femme et de sa richesse culturelle. Ah, ça, les soirées étaient toujours très intéressantes, jamais de temps morts, jamais de discussions d’aimables et hypocrites politesses. Diana était belle, fine et particulièrement élégante. Elle l’était encore en ce jour, alors que ses pensées partant à la dérive, fracassaient tout reste de cohésion dans son esprit malade. Leur couple n’existait déjà plus en tant que tel mais dans le regard des autres, celui que l’on nous renvoie et qui nous flatte, il était le parfait mari, attentionné, charmant et charmeur, qui rendaient jalouses les étudiantes. Avec sa tenue un peu stricte et sa coupe de cheveux toujours impeccable, Diana quand à elle donnait l’impression de vivre à l’époque des ouvrages qu’elle étudiait avec ses élèves. La littérature anglaise pouvait être captivante, voire enivrante, et les étudiants s’amusaient régulièrement à imaginer leur professeur navigant dans les eaux troubles d’une dimension parallèle où réalité et littérature ne font qu’un. S’ils savaient ! Aucun fantasme n’avait été si proche de la réalité. Fractionnée entre son désir d’être et de ne plus être, Diana avait un pied dans un monde moderne de technologie et de bruit, et l’autre dans un univers fait de fioritures verbales où chaque mot, chaque enluminure prenaient vie. Lorsqu’elle entrouvrait les yeux, elle voyait des oiseaux de Paradis s’envoler avec les syllabes et des Lys envahir des pièces trop vides. Lorsqu’elle les ouvrait davantage, elle voyait la noirceur d’un monde qui s’effondrait dans un grand fracas de pixels. La vie se fractionnait, se décomposait et un jour, cela ne faisait aucun doute, la contagion viendrait jusqu’aux siens, la détruisant, la transformant en autant de micro-cubes de couleurs plus sombres et ternes les uns des autres ! Il lui fallait fuir sans attirer l’attention sur sa lucidité. Elle se haïssait de tant d’égoïsme, mais dans cette tourmente, c’était chacun pour soi. Elle se demandait parfois si les autres existaient encore en tant qu’individu, ou s’ils étaient liés par un pacte secret et destructeur dont elle était l’unique survivante. Son mari, ses amis, ils n’étaient plus que les pions, acteurs passifs et ignorants d’un monde qu’elle ne comprenait pas et ne voulait surtout pas faire sien. Alors elle faisait illusion, niant le temps et la vie qui l’entourait, se construisant un rempart, une forteresse où le moment venue elle se cacherait. Et le moment était venu.
Elle ignorait d’où provenait l’attaque et cela l’effrayait. Elle la sentait monter en elle chaque fois avec plus de vitalité, durant plus longtemps, et s’attardant davantage encore. Au début elle avait cru pouvoir lutter contre la douleur, mais évidemment qu’aurait-elle pu faire seule contre tous ?! Alors elle avait foncé dans son refuge secret et y était restée des heures, des jours, des années peut-être ?
Le temps est illusion, mais l’illusion est douce. Diana y était bien, vivant en spectatrice le martyr qu’Ils infligeaient à son corps. Elle se voyait couverte de sueur, haletant comme un chiot épuisé, geignant puis serrant les dents pour lutter contre l’irrésistible. Quelle nécessité avait le Monde d’accompagner la mort et la destruction de la souffrance et de l’agonie? Si le doute subsistait encore que le Monde fut cruauté et ceci spécifiquement à son endroit, celui-ci venait d’être détruit, comme les prémices de l’apocalypse qui l’attendait. Son corps se convulsait et se raidissait alternativement, comme une musique silencieuse que le corps cherchait à rythmer. Elle se laissait un instant bercer par la mélopée hypnotique, oubliant les images de son corps. Puis une chaleur douce et réconfortante l’envahit. Cela la rassurait, du moins dans un premier temps, jusqu’à ce qu’elle réalisa que si le froid était bleu, le chaud était rouge ; comme le sang qui s’échappait loin d’elle. Voila donc comment serait sa fin ? Elle sentait son corps se vider, comme s’il cherchait à la fuir. Au départ, la sensation n’était pas déplaisante mais rapidement la souffrance s’était décuplée et à la place de liquide c’était sa propre chair qui tentait de s’extirper hors de ses entrailles. Ce qu’elle percevait, elle ne pouvait le définir autrement que « sensation ». Ce n’était ni de la douleur, qu’elle avait fait sienne depuis longtemps, ni du plaisir… Quel plaisir y-avait-il à sentir son corps la rejeter et la fuir ? Car c’était bien ce qu’il se passait. Une partie d’elle se frayait un chemin vers la sortie, empruntant sans doute la seule voix accessible. Une envie furieuse de pousser l’envahissait et c’était ce qu’elle faisait, avec hargne, avec rage, avec haine. Puis il n’y avait plus rien eut d’autre que le vide. Une sensation de libération qui en une fraction de seconde avait fait disparaitre toute douleur, ne laissant qu’un grand néant, un grand Rien-du-tout.
Diana avait les yeux fixés ce néant, cette absence de tout qui voulait l’engloutir. Finalement cela était presque rassurant. Il était si simple de se laisser aller et si compliquer de lutter. Elle était ainsi, ni présente, ni absente, simplement en attente, comme un ordinateur que l’on reprogramme, vierge et passive. Soudain une douleur était venu la surprendre, l’arracher à sa douce torpeur. C’était fugace, une décharge électrique rappelant à l’ordre. Diana était vivante et son corps refusait de la laisser partir. Celui qui venait de l’abandonner, refusait de la laisser mourir sereine. Il voulait qu’elle se sache et se sente démembrée, une partie d’elle vagissante sur le sol. Elle refusait d’ouvrir les yeux, luttant contre elle-même, contre son corps qui l’avait trahit.
Le temps durait depuis une éternité, juste ce qu’il lui fallait pour revenir dans une certaine réalité, mais pas assez pour qu’elle puisse réintégrer son corps dans son intégralité. Déboussolée, un peu perdue, Diana se demandait ce qu’elle faisait ainsi allongée sur le sol de son petit salon. Son regard encore embrouillé s’était alors porté vers ses pieds et un bel ouvrage d’Herbert Spencer «
The man versus the State », qui baignait dans du sang.
« Pourvu qu’il ne soit pas abîmé ! »
Ses paroles l’angoissaient mais le son de sa voix lui donnait une étrange sensation de vie et de douceur. En écho, elle entendait un lointain petit chuintement, de petits bruits comme ceux d’un oiseau tombé du nid. Elle tournait sa tête et le découvrait enfin. Il était lové contre sa cuisse. Sa première réaction fut le rejet. Elle se souvenait de tout, de la douleur, du morcellement de son corps… Comment cette chose pouvait-elle être en vie ?! Puis ce fut l’amour, celui passionnel et incommensurable qui unie parfois certains êtres, certaines âmes. Elle le prit dans ses bras, se jurant de le protéger contre vents et marrées, contre les tempêtes du Monde, contre lui- même s’il le fallait !
Et c’est ce qu’elle fît, emprisonnant le petit oisillon dans une cage où volaient les mots d’auteurs et les maux d’amour.
***
Maintenant l’oiseau s’est envolé, mais dans sa tête restent emprisonnés les maux d’amours du monde entier.